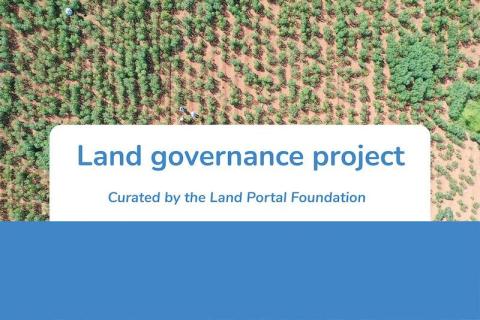Alors que les marchés du carbone continuent de se développer et que les pays s'empressent d'élaborer des réglementations nationales sur le carbone, la question des droits des peuples autochtones et des communautés locales - en particulier en matière de foncier - s'impose au coeur des débats. Le sixième épisode de la série de webinaires ALIGN, qui s'est tenu le 27 mars 2025, a réuni des intervenants des Philippines, de Zambie, du Brésil et de la communauté internationale engagée dans la défense des droits humains afin d'examiner la façon dont ces droits étaient pris en compte - ou mis de côté - dans les stratégies carbone en cours d'élaboration à l'échelle des pays.
Modéré par Sabine Frank, directrice exécutive de Carbon Market Watch, le webinaire a permis d'analyser la manière dont les systèmes de crédit carbone se heurtent à des problèmes fonciers de longue date et la manière dont les gouvernements, la société civile et les communautés y répondent. Comme l'a souligné Mme Frank dans son allocution d'ouverture, "le débat d'aujourd'hui ne part pas du principe que le respect des droits fonciers résoudra tous les problèmes. Cependant, le respect des droits fonciers dans les réglementations carbone est au centre de nos préoccupations aujourd'hui".
Les marchés du carbone: la question des régimes fonciers négligée
Rebecca Iwerks, directrice de l'Initiative mondiale pour la justice foncière et environnementale à Namati, a ouvert le débat en formulant la question centrale suivante : "Les projets carbone basés sur la nature ont un impact sur de vastes étendues de terres, souvent dans des zones rurales comme les forêts et les mangroves. Ces terres sont, dans leur majorité, sous régimes fonciers informels ou précaires". Elle relève une lacune préoccupante en ce qui concerne les politiques publiques : alors que les normes mondiales établissent souvent un lien entre les droits fonciers et la biodiversité ou gestion des forêts, "les normes des marché du carbone sont moins cohérentes".
Ces problématiques sont urgentes en raison de la mise en œuvre de l'article 6 de l'Accord de Paris, en particulier les paragraphes 6.2 (échanges bilatéraux) et 6.4 (marché volontaire), qui encouragent les pays à développer leurs politiques carbone dans les meilleurs délais. Comme le souligne Mme Iwerks, les réglementations sont élaborées alors que les projets sont déjà en cours, une précipitation qui présente des risques en matière de violations des droits. "Plus de la moitié des pays riches en forêts n'ont pas de droits clairement définis sur le carbone", a-t-elle ajouté, citant une étude conjointe de RRI et de l'université McGill.
Perspectives nationales : les Philippines, la Zambie et le Brésil
Aux Philippines, Edna Maguigad, spécialiste des questions juridiques et politiques, a décrit une évolution qui s'est jouée sur une décennie, depuis la préparation au programme REDD+ jusqu'aux efforts plus récents visant à réglementer les marchés volontaires du carbone. Bien que le pays dispose de garanties existantes en matière d'environnement et de droits des peuples autochtones, un certain nombre de lacunes opérationnelles subsistent. "Les forêts restantes se trouvent principalement sur des terres ancestrales, où les droits se chevauchent et où les mandats ne sont pas clairs", a fait remarquer M. Maguigad. Si le processus de CPLE (consentement préalable, libre et éclairé) est une obligation légale, Mme Maguigad souligne que "le commerce du carbone est considéré comme une activité extractive et doit faire l'objet d'un processus de CPLE rigoureux et exhaustif". En 2025, une série de directives liées au CPLE ont été introduites lesquelles reconnaissent explicitement les droits des peuples autochtones sur les crédits carbone, ce qui constitue une étape politique majeure.
En Zambie, Isaac Mwaipopo, directeur exécutif du Centre for Trade Policy and Development, a retracé l'évolution des politiques en matière de carbone depuis la loi sur les forêts de 2015 et la loi plus récente sur l'économie verte et le changement climatique de 2024. Bien que les communautés forestières aient été autorisés à participer aux marchés du carbone, Mwaipopo a insisté sur la persistence de lacunes : "La plupart des opérateurs de projets carbone sont des agents extérieurs, et les communautés s'inquiètent de ne pas savoir combien de revenus sont générés." Les chefs traditionnels, qui exercent une influence considérable sur les terres coutumières, sont souvent des médiateurs qui assurent un rôle de protection, mais "certains abusent de leur autorité et prennent des décisions qui ne profitent pas aux communautés".
Au Brésil, Johny Fernandes Giffoni, avocat de l'Etat de Pará et expert en droit socio-environnemental, a décrit un paysage juridique complexe. Alors qu'une loi fédérale de 2024 - la loi 15.042 - exige la consultation et le consentement des peuples forestiers en vertu du droit international (Convention 169 de l'OIT), M. Giffoni a constaté un décalage entre les protections juridiques et la mise en œuvre sur le terrain. "Nous vivons un chaos foncier en Amazonie", a-t-il déclaré en citant le professeur Girolamo Treccani. En réponse, les communautés élaborent des "protocoles de consultation autonome" pour documenter et défendre leurs droits. M. Giffoni a mis en lumière un cas à Pará où les communautés ont déclaré que "les crédits carbone constituent une menace silencieuse et inconnue".
Le rôle du CPLE et du partage des bénéfices
Tous les participants s'accordent à dire que les processus de CPLE sont essentiels, mais qu'ils sont insuffisamment développés. Mme Maguigad a souligné qu'aux Philippines, les négociations sur le partage des bénéfices se déroulent dans le cadre du CPLE. "Il est essentiel de s'assurer que les projets carbone sont conçus en collaboration avec les communautés et qu'ils reflètent leurs réalités sociales et écologiques".
M. Mwaipopo a indiqué que les OSC étaient de plus en plus impliquées en Zambie, mais que leur participation n'était pas encore pleine et effective. "Les communautés ne sont souvent impliquées qu'à la fin du processus et le partage des bénéfices reste opaque". Au Brésil, M. Giffoni a décrit les actions judiciaires intentées contre des opérateurs de projets carbone qui n'avaient pas mené de consultations appropriées et qui avaient utilisé des clauses contractuelles abusives. "Les communautés se défendent en utilisant des outils juridiques et en formant des alliances avec les universités et la société civile".
Données foncières et biodiversité : les chaînons manquants
Le wébinaire s'est également penché sur l'importance des données foncières. "Il n'est pas possible de mettre en place des réglementations équitables en matière de carbone si l'on ne dispose pas de données foncières transparentes, accessibles et précises", a déclaré Mme Iwerks. Les pays doivent être en mesure de cartographier les zones où les régimes fonciers sont clairs et celles où ils sont précaires, et d'évaluer les zones où des conflits peuvent surgir. Mme Maguigad et M. Mwaipopo ont tous deux confirmé que leurs pays ne disposaient ni de registres de projets carbone intégrés ni de données foncières géolocalisées, ce qui nuit aux principes de responsabilité.
Le lien entre le stockage du carbone et la biodiversité a également fait l'objet d'une attention particulière. Alors qu'en théorie les projets carbone peuvent également remplir des objectifs de conservation de la biodiversité, dans la pratique il y a souvent des conflits d'intérêt. En Zambie, M. Mwaipopo a décrit la façon dont des permis carbone et des permis d'exploitation minière pouvaient se chevaucher sur de mêmes espaces. "Nous avons besoin de lois claires pour résoudre ces conflits et protéger les zones riches en biodiversité". M. Giffoni a ajouté qu'au Brésil, "la biodiversité est souvent compromise dans la hâte d'établir des marchés du carbone".
Conclusions et perspectives d'avenir
Une même mise en garde a été formulée pour l'ensemble des cas: les réglementations sur le carbone élaborées en l'absence de régimes fonciers sécurisés et d'une véritable participation des communautés risquent d'aggraver les injustices sociales et environnementales.
Les participants ont également posé des questions et exprimé des inquiétudes au sujet des limites potentielles des protections juridiques et du CPLE compte tenu de lacunes en matière de leur mise en œuvre. Ils remarquent que les conflits se multiplient et que dans certains contextes, les peuples autochtones et le droit au CPLE ne sont pas reconnus, et soulignent que la pertinence des projets carbone comme solution au changement climatique fait débat.
Comme l'a conclu Sabine Frank, "les droits fonciers ne sont pas la solution miracle, mais ils sont un pilier essentiel. Sans eux, c'est toute la structure des marchés du carbone qui devient instable".
Plusieurs chantiers prioritaires ont été mis en évidence avant que les gouvernements ne modifient leurs réglementations nationales:
- Clarté juridique sur les droits carbone et les mécanismes de partage des bénéfices.
- Des processus de CPLE plus robustes et mieux mis en œuvre, avec une attention particulière pour les systèmes juridiques autochtones.
- Le besoin de protection - le droit des personnes à s'exprimer sur la façon dont leurs terres sont impactées sans subir de représailles.
- Des systèmes transparents de données sur les terres et le carbone accessibles aux communautés.
- L'élaboration de politiques multipartites inclusives, qui commencent - et non qui se terminent - par les voix des populations locales.
Alors que les gouvernements travaillent à l'élaboration de réglementations sur le carbone et que les marchés mondiaux du carbone prennent forme, le défi n'est plus de savoir s'il faut impliquer les communautés et le grand public, mais comment le faire. "Les communautés ne sont pas seulement des parties prenantes", a déclaré M. Iwerks. "Ce sont des détenteurs de droits. Il est temps que les politiques en matière de carbone reflètent cette réalité".